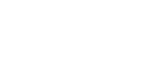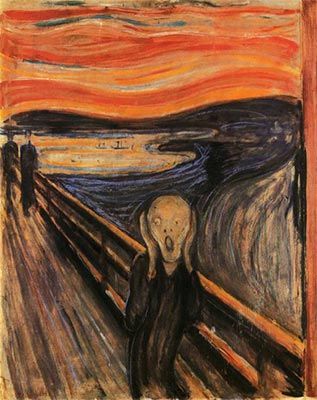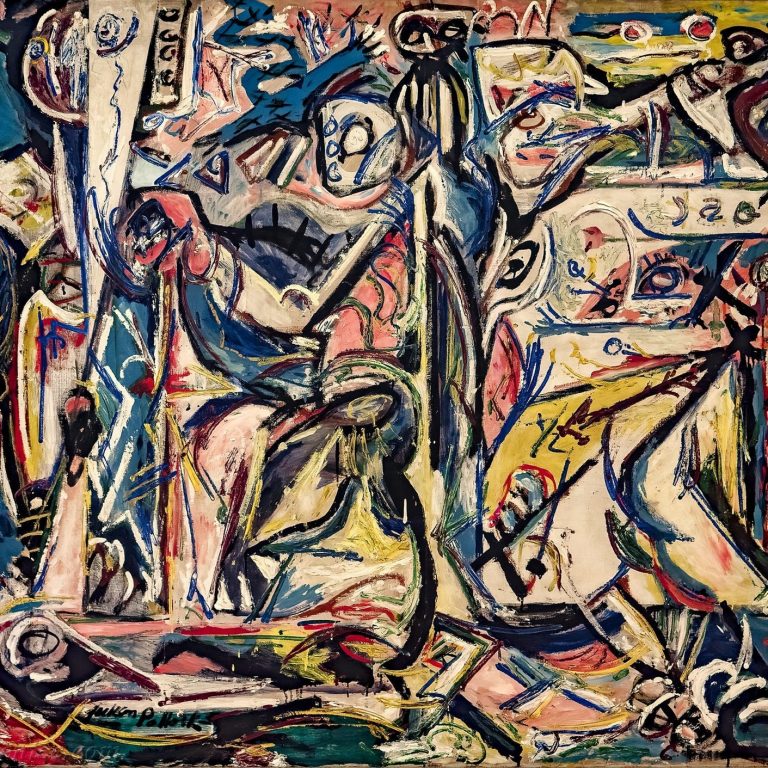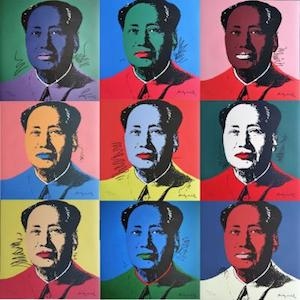L’hyperréalisme est un courant artistique contemporain né à la fin des années 1960 aux États-Unis et en Europe. On l’associe souvent à la peinture et à la sculpture, mais il a aussi touché la photographie et d’autres médiums.
Voici les points essentiels :
Origine
- Inspiré du Pop Art et de la photographie, l’hyperréalisme prolonge le photoréalisme, mais avec une dimension plus sensible et parfois critique.
- Le terme Hyperréalisme a été popularisé en 1973 lors d’une exposition à Bruxelles par le marchand d’art Isy Brachot.
Caractéristiques
- Représentation extrêmement détaillée, souvent plus précise qu’une photographie.
- Travail minutieux sur la lumière, les textures (peau, métal, eau, verre, etc.), les reflets.
- Les œuvres visent à donner une illusion totale du réel, parfois jusqu’à l’étrangeté.
- Contrairement au photoréalisme “froid”, l’hyperréalisme introduit souvent une dimension émotionnelle, narrative ou critique.
Thèmes
- Portraits ultra-détaillés (rides, pores, reflets dans les yeux).
- Objets du quotidien, natures mortes, environnements urbains.
- Corps humains représentés avec une intensité presque troublante.
- Scènes banales sublimées ou mises en lumière par leur réalisme extrême.
Artistes majeurs
- Chuck Close (portraits monumentaux).
- Richard Estes (scènes urbaines avec reflets dans les vitrines).
- Audrey Flack (natures mortes hyperréalistes).
- En sculpture : Duane Hanson et John De Andrea (figures humaines grandeur nature, bluffantes de réalisme).
- Plus récemment, des peintres comme Roberto Bernardi (objets, transparences), Diego Fazio (dessins au crayon) ou Gottfried Helnwein (grands portraits) prolongent ce courant.
Réception
- Parfois critiqué comme une prouesse technique sans “âme”.
- Mais reconnu comme un art qui interroge notre rapport à la réalité, à l’image, et à la photographie.
- Aujourd’hui, l’hyperréalisme connaît un regain d’intérêt, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la fascination pour l’illusion visuelle.